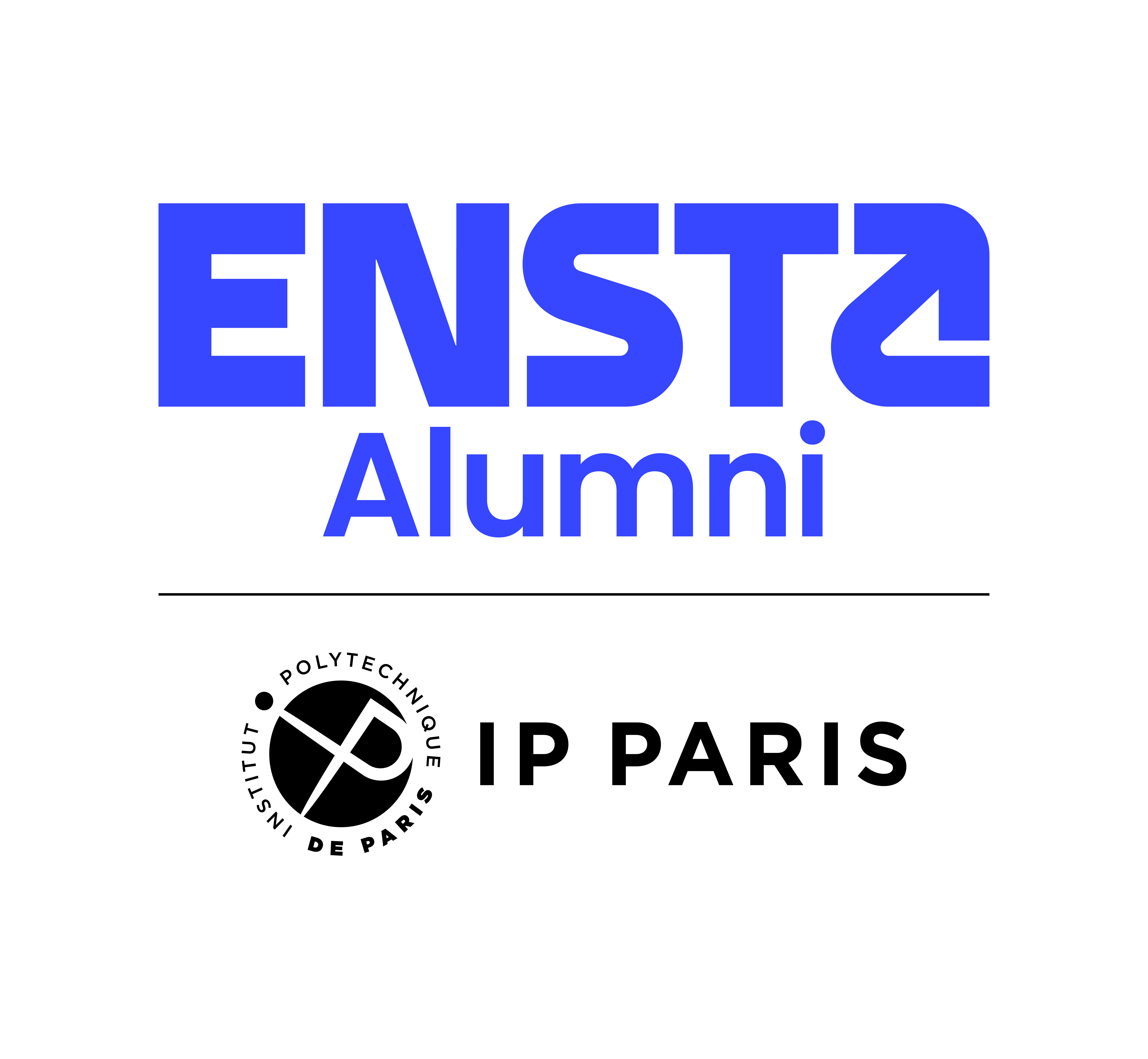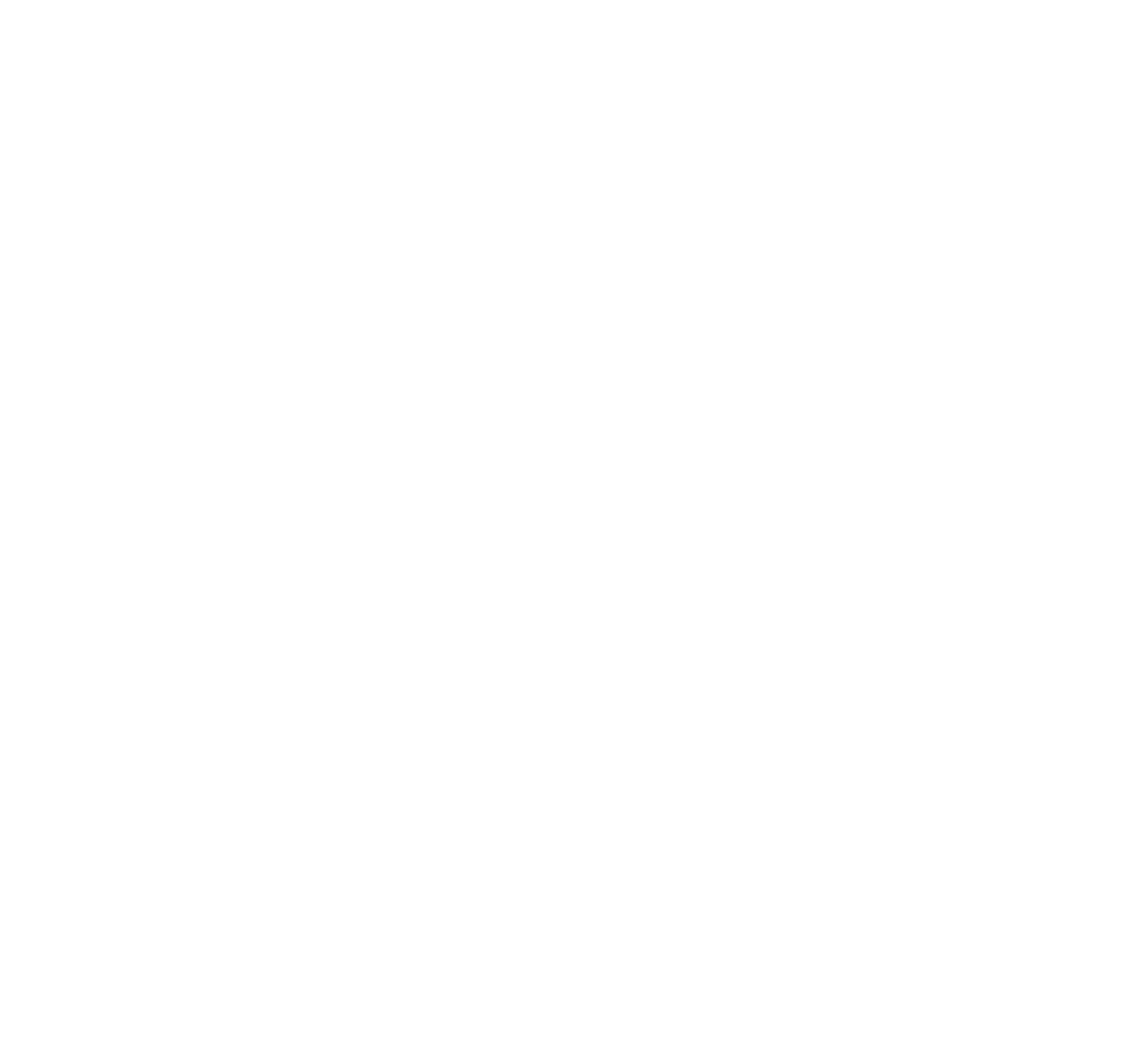Interview de Julien LE GOFF (promo 1997)
Interview réalisée dans le cadre du dossier "Ingénieurs ENSTA Paris et nucléaire"

En quoi consiste ton métier ?
JLG. : Je suis en charge de définir avec les services de l’État le cadre de financement et de régulation nécessaire au développement des prochains réacteurs nucléaires français, dits « EPR2 ». C'est un métier qui nécessite une bonne compréhension des enjeux financiers, du droit de la concurrence européen et du fonctionnement du marché de l'électricité.
Quel a été ton cursus académique, et en particulier ta spécialisation à ENSTA Paris ?
JLG. : J'ai suivi un parcours classique d'ingénieur avec un baccalauréat scientifique, des classes préparatoires et une école, ENSTA Paris. En troisième année, souhaitant travailler dans la production d'électricité, j'ai suivi l’option « énergie nucléaire » pour 75% de mon cursus ; les 25% restants m’ont permis d'approfondir un sujet qui me tenait à cœur : l'espace, avec le module de « propulsion spatiale ».
Quelles ont été les grandes étapes de ton parcours depuis ta sortie de ENSTA Paris ?
JLG. : J'ai commencé dans l'ingénierie chez EDF, sur un tout autre sujet que le nucléaire : la rénovation et la construction de centrales thermiques au charbon et au gaz. À l'époque, l’enjeu était de réduire les émissions (particules, NOx et SOx) et de prolonger l'exploitation en toute sécurité d'installations fortement sollicitées lors du suivi de charge par des arrêts / redémarrages fréquents avec toutes les problématiques de vieillissement des matériaux et de chocs thermiques que cela implique.
J'ai ensuite occupé différentes fonctions de consultant, d’expert et de manager dans plusieurs métiers du groupe : réseaux de distribution, RH, direction financière, commerce BtoB, direction de la stratégie. J'ai pu y développer une certaine expertise dans les domaines du fonctionnement du marché, du système électrique, du financement d'activités, des enjeux européens, de la négociation de contrats complexes et de la compréhension des jeux d'acteurs et des dynamiques de groupe.
J'ai ensuite occupé différentes fonctions de consultant, d’expert et de manager dans plusieurs métiers du groupe : réseaux de distribution, RH, direction financière, commerce BtoB, direction de la stratégie. J'ai pu y développer une certaine expertise dans les domaines du fonctionnement du marché, du système électrique, du financement d'activités, des enjeux européens, de la négociation de contrats complexes et de la compréhension des jeux d'acteurs et des dynamiques de groupe.
Peux-tu nous donner l’exemple d’une action, d’un projet significatif que tu as mené dans le domaine du nucléaire ?
JLG. : Dans le domaine du nucléaire, j'interviens plus sur l'équilibre économique de ce secteur que sur des sujets techniques.
La structure de coûts des centrales nucléaires impose un très fort besoin de cash avant la mise en service, avec ensuite des coûts d'exploitation limités durant 60 ans d'exploitation et des coûts de post-exploitation à anticiper. Ce n'est sans doute pas le seul secteur à présenter un tel profil, mais c'est à ma connaissance le seul qui fait face à une absence de visibilité sur ses revenus futurs, sur la place qui lui sera dévolue dans le mix électrique européen pour lutter contre le réchauffement climatique et qui nécessite un haut niveau d'expertise et d’anticipation de la part des ingénieurs. Si vous ajoutez des enjeux politiques nationaux autour du pouvoir d'achat et de la compétitivité de l'économie, vous comprenez assez vite l’importance de traiter cette question de l'équilibre économique de l'activité nucléaire dans la durée pour préserver la filière industrielle associée.
Avant de rejoindre le programme en charge des nouveaux réacteurs nucléaires, j'ai eu à négocier avec les services de l’État (eux-mêmes en discussion avec la Commission Européenne) la régulation qui devait se substituer en 2021 au dispositif actuel de l'ARENH (dispositif conduisant EDF à vendre à un prix fixé mais non garanti une très grande partie de sa production nucléaire). Cette discussion a commencé dans un marché sur-capacitaire, avec un prix du CO2 structurellement sous-évalué entraînant tous deux des prix de marché très bas et des opportunités d'arbitrage du dispositif ARENH préjudiciables à l'équilibre économique du parc nucléaire français ; une situation intenable pour le secteur nucléaire qui devait à la fois prolonger la durée de vie des centrales actuelles et relancer la construction de nouveaux réacteurs. Dans ce contexte, il a fallu expliquer d'une part, le caractère incertain des prix actuels, donc le besoin d'anticiper les hausses futures pour les consommateurs tout en autorisant une rémunération raisonnable de l'activité et d'autre part, trouver un schéma compatible avec le cadre européen et en particulier, un schéma préservant le fonctionnement du marché de gros de l’électricité. Si les discussions au niveau européen n'ont pu aboutir en 2021, ces quatre années de négociation auront permis d'éviter une dégradation de la situation, de faire la lumière sur la structure de coûts du parc nucléaire français et sur l’atout que constituait un tel parc pour le système électrique ; elles auront aussi permis un partage des limites du marché et de la nécessité de sortir de l'impasse tarifaire dans laquelle le parc nucléaire français a été placé. Au niveau européen, la crise énergétique post-Covid et le conflit en Ukraine sont venus brutalement confirmer les arguments et l'analyse que l’État français défendait quelques années plus tôt. Le nouveau Market Design retenu par l'Union Européenne en ce début d'année va dans le bon sens ; les discussions passées auront donc été utiles.
La structure de coûts des centrales nucléaires impose un très fort besoin de cash avant la mise en service, avec ensuite des coûts d'exploitation limités durant 60 ans d'exploitation et des coûts de post-exploitation à anticiper. Ce n'est sans doute pas le seul secteur à présenter un tel profil, mais c'est à ma connaissance le seul qui fait face à une absence de visibilité sur ses revenus futurs, sur la place qui lui sera dévolue dans le mix électrique européen pour lutter contre le réchauffement climatique et qui nécessite un haut niveau d'expertise et d’anticipation de la part des ingénieurs. Si vous ajoutez des enjeux politiques nationaux autour du pouvoir d'achat et de la compétitivité de l'économie, vous comprenez assez vite l’importance de traiter cette question de l'équilibre économique de l'activité nucléaire dans la durée pour préserver la filière industrielle associée.
Avant de rejoindre le programme en charge des nouveaux réacteurs nucléaires, j'ai eu à négocier avec les services de l’État (eux-mêmes en discussion avec la Commission Européenne) la régulation qui devait se substituer en 2021 au dispositif actuel de l'ARENH (dispositif conduisant EDF à vendre à un prix fixé mais non garanti une très grande partie de sa production nucléaire). Cette discussion a commencé dans un marché sur-capacitaire, avec un prix du CO2 structurellement sous-évalué entraînant tous deux des prix de marché très bas et des opportunités d'arbitrage du dispositif ARENH préjudiciables à l'équilibre économique du parc nucléaire français ; une situation intenable pour le secteur nucléaire qui devait à la fois prolonger la durée de vie des centrales actuelles et relancer la construction de nouveaux réacteurs. Dans ce contexte, il a fallu expliquer d'une part, le caractère incertain des prix actuels, donc le besoin d'anticiper les hausses futures pour les consommateurs tout en autorisant une rémunération raisonnable de l'activité et d'autre part, trouver un schéma compatible avec le cadre européen et en particulier, un schéma préservant le fonctionnement du marché de gros de l’électricité. Si les discussions au niveau européen n'ont pu aboutir en 2021, ces quatre années de négociation auront permis d'éviter une dégradation de la situation, de faire la lumière sur la structure de coûts du parc nucléaire français et sur l’atout que constituait un tel parc pour le système électrique ; elles auront aussi permis un partage des limites du marché et de la nécessité de sortir de l'impasse tarifaire dans laquelle le parc nucléaire français a été placé. Au niveau européen, la crise énergétique post-Covid et le conflit en Ukraine sont venus brutalement confirmer les arguments et l'analyse que l’État français défendait quelques années plus tôt. Le nouveau Market Design retenu par l'Union Européenne en ce début d'année va dans le bon sens ; les discussions passées auront donc été utiles.
De ton point de vue, quel rôle a / doit avoir l’ingénieur ENSTA dans ce domaine, notamment dans le cadre du plan France 2030 sur le nucléaire de demain et plus largement celui de l’objectif de neutralité carbone en 2050 ?
JLG. : Sur la base de l'expérience que je viens de décrire, la mission de l'ingénieur dans le domaine du nucléaire me semble impliquer de penser les problématiques dans la durée et dans une vision systémique. Dans bien des situations, l’ingénieur ne verra pas la mise en œuvre de la solution définitive... parce qu'il sera appelé à d'autres fonctions... ou simplement parce que les systèmes évoluent et s'adaptent aux changements (y compris aux solutions que nous proposons). L'ingénieur me semble donc avoir pour rôle d'éclairer au mieux les enjeux et les problèmes posés, de proposer des solutions robustes aux évolutions futures (avec une certaine flexibilité) et surtout d'intégrer le plus en amont possible le facteur humain et dans le cas présent les besoins des décideurs politiques d'une part et les attentes des parties prenantes d'autre part.
En quoi ENSTA Paris, par la formation qu’elle dispense aux futur(e)s ingénieur(e)s, aide-t-elle la France à atteindre ses objectifs en matière de renouveau du nucléaire ?
JLG. : ENSTA Paris dispense une formation qui permet d’embrasser toutes les dimensions de l’activité nucléaire. Elle permet aux futurs ingénieurs d’aborder les questions qui leur sont posées avec un regard plus large que la seule résolution du problème rencontré. Elle limite ainsi le risque qu’une solution à un problème « A » ne conduise à l’émergence d’un nouveau problème « B ». C’est une difficulté que je rencontre quotidiennement et qui vous oblige à explorer de nouveaux champs de compétences parfois très éloignés du métier d’ingénieur ; dans mon cas ce fut par exemple le droit de la concurrence et le droit fiscal. Quand je discute avec des collègues en charge de la conception et de la construction des nouveaux réacteurs, ils sont confrontés aux mêmes défis : embrasser la complexité dans le temps et la diversité des sujets qu’elle implique.
Plus largement, la formation dispensée par ENSTA Paris développe cette capacité à gérer la complexité et à proposer des voies de compromis. Cette capacité – et idéalement cette posture face aux questions – est essentielle pour répondre aux attentes multiples et parfois contradictoires de la société vis-à-vis du nucléaire d’une part et d’autre part, pour concevoir des installations capables de s’adapter à un environnement en pleine transformation du fait du réchauffement climatique.
Plus largement, la formation dispensée par ENSTA Paris développe cette capacité à gérer la complexité et à proposer des voies de compromis. Cette capacité – et idéalement cette posture face aux questions – est essentielle pour répondre aux attentes multiples et parfois contradictoires de la société vis-à-vis du nucléaire d’une part et d’autre part, pour concevoir des installations capables de s’adapter à un environnement en pleine transformation du fait du réchauffement climatique.
Gardes-tu un souvenir anecdotique de l'école ?
JLG. : Je gardes de très bons souvenirs de ma scolarité à ENSTA Paris et ils sont nombreux ! Difficile d’en isoler un en particulier. Mais puisque j’ai beaucoup parlé de formation, je voudrais ajouter l’importance qu’aura eu pour moi l’engagement associatif, ces moments où des petits groupes motivent toute une école autour d’objectifs et amènent chacun à se dépasser et à être fier d’un résultat. C’est en définitive une très belle école de management et de conduite de projets.
As-tu des conseils à donner aux élèves actuels ?
JLG. : Je vous conseillerais d’abord de vous faire plaisir dans le travail et dans la vie en général. Ensuite, intéressez-vous aux gens, sincèrement et de manière totalement désintéressée. Cela peut vous sembler « chronophage » ou « moins efficace », mais pour revenir sur le sujet de la complexité, s’intéresser aux autres est un levier important (pour ne pas dire le premier levier) pour gérer la complexité : soit parce que cette dernière repose sur l’humain (je vous renvoie ici à l’excellent cours d’ENSTA Paris sur la communication dont j’ai toujours le polycopié), soit parce que le regard de l’autre peut toujours vous apporter une piste à laquelle vous ne penserez jamais (a fortiori si l’autre n’a pas votre formation ou ne vient pas de votre milieu socioprofessionnel ou de votre pays). Si ce conseil vous paraît banal ou inutile… c’est qu’il est grand temps d’y réfléchir.
Consulter le profil de Julien LE GOFF